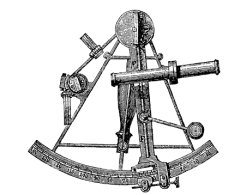L’affaire de Tarnac n’a perdu son étiquette terroriste qu’en 2017 , alors que l’instruction menée par des magistrats spécialisés était déjà clôturée depuis deux ans. Cette décision finale a beau avoir des conséquences pratiques sur le procès qui se tient depuis mardi – les prévenus, jugés devant un tribunal correctionnel ordinaire, risquent au maximum cinq ans de prison –, elle ne peut rien changer à l’architecture du dossier. Celui-ci a été construit depuis 2008 sous l’égide d’une législation d’exception qui s’intéresse davantage au mode de vie et aux intentions des suspects qu’à leurs agissements exacts en telle ou telle occasion. Pendant toute la deuxième journée d’audience mercredi à Paris, les huit prévenus ont prouvé leur détermination à discuter chacun des mots choisis à l’époque par la police. Le rouleau compresseur de l’antiterrorisme est passé sur leurs existences, avant de se retirer, mais le vocabulaire décrivant leur vie quotidienne s’en est tout de même retrouvé aplati.
La question du langage adéquat se pose systématiquement : la ferme du Goutailloux, propriété agricole animée en commun ou « base logistique en province » ?
Alors que la présidente Corinne Goetzmann reprenait, ce mercredi, les éléments déclencheurs de l’enquête initiale, la question du langage adéquat s’est systématiquement posée. Comme sur la ferme du Goutailloux, à Tarnac, achetée à plusieurs en 2005 pour 210 000 euros. Est-ce une simple propriété agricole animée en commun, ou une « base logistique en province », comme l’écrivaient les enquêteurs en 2008 ? Interrogé sur « le projet » qui sous-tendait l’achat de la ferme, Julien Coupat, avec sa tête de Guy Debord qui se réveille à l’époque de Yann Moix, s’est élevé contre « la trame de suspicion posée par le récit initial ». À ses yeux, « des désirs communs, des amitiés, des activités agricoles et autres » ont été transformés en un scénario qu’il « juge délirant d’un bout à l’autre », engageant simplement le tribunal à « changer de regard ».

Prenant la suite, Benjamin Rosoux, l’un des propriétaires du Goutailloux, souligne que les photos lointaines et arborées du bâtiment, issues du dossier et projetées à l’audience, ont été prises par la DCRI « au téléobjectif depuis la crête d’une colline à 200 mètres, alors qu’il y a une route en bas qui passe devant la ferme ». Une « mise en scène » visuelle qui contribue, selon lui, à donner cette impression « d’une base arrière des Farc ». Là où il n’y aurait en fait aucun mystère. Benjamin Rosoux rappelle qu’il comparaît finalement devant le tribunal pour un simple refus de prélèvement ADN, après « 96 heures de garde à vue, quinze jours de prison, un an d’assignation à résidence et dix ans de procédure antiterroriste ». Et que ni lui, ni les autres prévenus n’ont l’intention de « se soumettre à la question » en racontant à quoi ressemblait leur vie à la campagne. Mathieu Burnel complète : « Ce qu’on fait, ce qu’on aime, ce qu’on entreprend avec nos amis n’a pas vocation à être rendu transparent par la justice. » Il ne veut pas donner les « éléments d’ambiance » réclamés par la présidente, car ils permettraient, estime-t-il, de faire tenir l’édifice de l’accusation. « Sinon, on a quoi ? Un bouquin[L’Insurrection qui vient, ndlr], une ferme, des dégradations. Ça ne suffit pas. »
La présidente n’arrive pas à obtenir d’autre réponse. Après s’être fendue d’un couplet pédagogique sur l’importance de donner sa version, elle ne reçoit de Julien Coupat qu’une tirade sur la permanence de la procédure pénale depuis le XVe siècle. « Et les magistrats se plaignent qu’il y a une nouvelle loi chaque année… » plaisante-t-elle, avec un franc succès dans une salle qui ne lui est pourtant pas acquise.
C’est lorsque le couple franchit de nouveau la frontière dans l’autre sens, pour retourner au Canada, qu’il se fait attraper par la douane canadienne. Leurs sacs sont fouillés et la description de leur contenu scrupuleusement versée ensuite dans l’enquête française. Tout un tas de choses, parfois inutiles : des vêtements, des livres, « une brosse à dents mauve », une facture de chaudière, mais surtout un bout de papier qui leur causera du tort plus tard. Sur ce qui ressemble à une liste de courses, Julien Coupat a écrit, parmi d’autres choses, « gants 25 000 W ». Des gants isolants, ne serait-ce pas une préfiguration du matériel nécessaire au sabotage des caténaires sur les voies TGV ? L’intéressé y voit « la lecture opportune et paranoïaque a posteriori des services de renseignement ». Il explique qu’au Magasin général, l’épicerie de Tarnac, il lui arrivait très souvent de faire des listes de courses collectives, et que celle-ci en fait partie, sans qu’il se rappelle précisément à quoi devaient servir ces gants. D’autres listes mentionnaient « des bouteilles de gaz », sans qu’on les lui reproche, ce qui le fait beaucoup rire. Ses deux gardes du corps, l’avocat Jérémie Assous et Mathieu Burnel, le bourrent de petits coups en douce pour qu’il la mette en sourdine.
Lorsque vous grillez filature sur filature en permanence, vous savez que vous allez vous faire arrêter.
Julien Coupat, à l’audience
Dans les mois qui précèdent la vague d’arrestations du 11 novembre 2008, Julien Coupat est très surveillé. À la fois par la DCRI et par la police antiterroriste (la Sdat), chargée de l’enquête judiciaire. Faute de posséder un téléphone portable, il ne peut pas être placé sur écoute, mais tous ses proches le sont. Une caméra est installée dans les parties communes de son immeuble parisien, filmant ses allées et venues et celles d’Yildune Lévy. Les filatures se font de plus en plus pressantes, au risque de devenir voyantes. Pour les déjouer, Julien Coupat sort du métro au dernier moment, quand la sonnerie retentit, afin de confondre les policiers qui seraient en train de le suivre. Lorsqu’il rend visite à certains de ses coprévenus, à Rouen, il sort brusquement de l’autoroute ou fait trois tours de rond-point pour voir qui fait la même chose. À l’audience, il raconte avoir facilement repéré des policiers, comme cette femme à la sortie d’une station-service, « une sorte d’inspecteur Gadget qui parlait à sa parka », qu’il s’est amusé à faire tourner en bourrique. Sans être dupe : « Lorsque vous grillez filature sur filature en permanence, vous savez que vous allez vous faire arrêter. » Il espère ainsi démonter le mythe de ses « stratégies clandestines ». Forçant le procureur, Olivier Christen, à intervenir pour dire l’inverse : « Je pense que monsieur Coupat est un excellent conteur, mais qu’il n’a jamais repéré les surveillances. Il essaie de faire croire cela parce qu’il veut se montrer beaucoup plus malin que les policiers. » Pourtant, comme le souligne Jérémie Assous, « même les policiers se plaignent, dans les PV, que Julien Coupat n’arrête pas de les repérer ».
À la fin d’une deuxième journée très dense, reste encore à examiner un terme très discutable dans cette enquête : « l’association de malfaiteurs ». Initialement, elle était terroriste et Julien Coupat la dirigeait. Aujourd’hui, elle a perdu son épithète et il en est un simple membre, au même titre qu’Elsa Hauck et Bertrand Deveaud, qui n’ont plus que ça à se reprocher – ils risquent tout de même cinq ans de prison. Pour caractériser ce délit, le dossier retient une manifestation parmi beaucoup d’autres, celle qui a lieu à Vichy le 3 novembre 2008, une semaine avant les arrestations.

Ce point est un peu complexe. Plusieurs prévenus ont reconnu s’être rendus à Vichy pour participer à une manifestation contre un sommet européen sur l’immigration. Aucun ne s’y est fait arrêter ou n’a été poursuivi pour les violences et dégradations commises alors. Mais Julien Coupat, Elsa Hauck et Bertrand Deveaud sont soupçonnés de s’être entendus sur des actions violentes à mener là-bas lors d’une « réunion préalable » à Rouen, qu’eux décrivent comme « un repas » où ils ont parlé de divers sujets dont la manifestation. Julien Coupat aurait alors suggéré aux autres de se procurer une corde, qui devait servir à « tirer » les barrières de CRS censées bloquer le passage des manifestants pour les écarter. Un sommet de l’immigration à Vichy, « ça nous a remplis de fureur, et pour ma part, je suis fier que nous ayons manifesté ce jour-là », explique Julien Coupat. « Je pense que de temps en temps, il faut poser des bornes aux gouvernants, sinon ils font n’importe quoi. »
Un PV de surveillance décrit Julien Coupat, lors d’une manifestation à Vichy, comme une sorte de général d’empire. Lui qualifie la manif de « chaleureuse »
Elsa Hauck et Bertrand Deveaud se sont en tout cas procuré une corde, mais celle-ci leur a été confisquée avant la manif. Quand bien même elle aurait servi, explique Julien Coupat, que « c’est le contraire d’une dégradation, qui consiste à prendre le réel et l’abîmer. Il y a quelque chose de l’ordre d’Intervilles : un élément ludique, rituel et non offensif. » Bertrand Deveaud, le plus timide des prévenus, conteste « le champ lexical » qui lui est prêté dans son PV de garde à vue, comme l’idée que Julien Coupat aurait assuré un « briefing ».
Au terme du récit de la présidente, des interrogatoires des trois prévenus et des interventions du procureur Nicolas Renucci, plus personne ne comprend très bien si c’est l’acquisition de la corde, le projet d’utiliser la corde ou la concertation autour de la corde qui permettrait de caractériser cette association de malfaiteurs. Dans un PV de surveillance, Julien Coupat est décrit comme une sorte de général d’empire qui manœuvrerait les troupes à distance à l’aide d’un mégaphone et de messes basses. Lui décrit la manifestation comme « chaleureuse ». « Comme quoi, la sémantique, c’est particulier », note Corinne Goetzmann. Il est 20 heures passées. Christophe Becker, un prévenu silencieux depuis le début, craque. « Nous sommes en train de parler depuis deux heures d’une manifestation qui a eu lieu il y a dix ans », dit-il. « Je ne comprends pas ce qu’on fait là. » C’est pourtant simple : on débat du sens des mots. Et ça peut durer dix ans de plus.