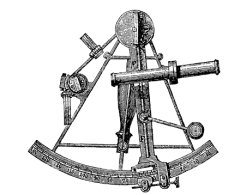Je ne vais évidemment pas conclure ou pré conclure puisque maître Thierry Lévy aura le dernier mot et beaucoup de choses ont été dites qui sont sans doute aussi, sinon plus, pertinentes que ce que je vais pouvoir dire. En clin d’œil, je dirais que l’invitation qui m’a été faite de conclure a peut-être été faite à l’ancien rubricard policier. L’échange que vous avez eu tout à l’heure montre qu’il y a aussi dans la police des batailles au nom d’idéaux républicains, démocratiques, qui peuvent se mener. Dans tous les cas la société doit tout faire pour que les policiers qui les mènent soient soutenus et ne se sentent pas isolés.
Plus sérieusement je pense que si je suis là c’est parce que, aujourd’hui cela paraît très loin, au début 2009, quelques mois après le début de l’affaire de Tarnac, alors que Julien Coupat était encore détenu, à une époque où l’on parlait des neuf de Tarnac puisqu’un dixième se rajoutera fin 2009. Médiapart a pris position sous ma plume, en expliquant que ce que nous appelions, pardon aux 8 puis 9 autres, l’affaire Coupat : Pourquoi l’affaire Coupat nous concerne tous ? C’était une prise de position éditoriale qui venait en complément d’un travail d’enquête fait notamment par David Dufresne, qui était à Médiapart à l’époque, et qui a été poursuivi par d’autres journalistes de Médiapart, sur les failles, sur les contradictions, sur les silences des investigations qui ont amenées ces mises en examens et à ces détentions.
C’est dans Médiapart que l’on avait pu avoir la révélation, non seulement de l’existence de ce témoignage sous x, de ce témoignage anonyme, mais de ce témoignage anonyme d’un témoin anonyme lui-même tout ce qu’il y a de plus mythomane et ayant déjà été pris dans un témoignage qui s’est révélé être de la pure mythomanie. C’est dans Médiapart qu’on avait pu lire ces petites déclarations des enquêteurs ou juges d’instructions disant qu’il fallait leur souhaiter bonne chance par ce qu’ils allaient en avoir besoin, en clair, parce qu’ils devaient essayer de faire tenir, à posteriori, un dossier qui était très fragile. Encore récemment Médiapart a refait très concrètement le terrain d’enquête du rapport policier pour montrer ses invraisemblances en termes de chronologie, en termes de timing, un petit peu comme à d’autres époques des journalistes, dont j’étais, avaient fait la route entre Valencienne et Paris pour montrer comment Bernard Tapie était un menteur professionnel. Donc nous avons fait ce travail et c’est sans doute pour cela que je suis là. Ce que je voudrais dire en conclusion ce n’est pas en tant que journaliste mais en tant que citoyen, ce qui pour moi est tout à fait lié, puisque je pense qu’il n’y a pas d’autres légitimité que le journalisme ouvert à la critique et à la contestation, et la nécessité pour les citoyens d’une démocratie vivante, d’une démocratie faisant place au conflit, faisant place à la contradiction.
De ce point de vue, l’affaire de Tarnac, cela a été dit par beaucoup d’orateurs, est une affaire symbole, est une affaire levier, est une affaire laboratoire dont on doit se saisir, d’autant plus qu’elle est dans un temps bref, dans un temps court. Qu’il n’y a pas l’aveuglement que crée parfois le drame, que crée parfois la violence, et nous pouvons réveiller les consciences à partir de cette affaire, comme la mise en évidence du péril qui menace les principes démocratiques vitaux aujourd’hui. Non seulement sur la présomption d’innocence mais les libertés d’opinions et d’expressions, voir plus que cela, je dirais la liberté de conscience. C’est-à-dire le libre choix des valeurs qui conduisent une existence puisqu’au fond, c’est aussi ce qui a été reproché. Ce qui a permis de cibler les jeunes de Tarnac, c’est le fait qu’ils aient fait le choix de vivre à l’écart, en contradiction, en conflit avec une société de la marchandise, une société de la vitesse, une société du profit, une société de la consommation.
Cela a été dit sur tous les tons par tous ceux qui connaissent ce dossier, il y a derrière tout cela bien plus que l’affaire de Tarnac. Et depuis l’affaire de Tarnac nous avons entendu ces dernières semaines, encore hier, la façon dont on nous brandit l’attentat à venir, dont on nous l’annonce d’heure en heure, on est passé de mois en mois, puis de semaine en semaine, voir de jour en heure, voir d’heure en heure. Cet attentat prophétisait, cette attente au fond, par ce pouvoir actuel, de son « onze septembre », de son événement dramatique fondateur, de son levier pour mettre en œuvre une politique de la peur, ce qui dans le débat américain sur la présidence Bush et l’après onze septembre fut un concept clé pour la réflexion « politics of fear ».
La politique de la peur c’est la construction d’un objet, le terrorisme, et Antoine Comte l’a dit très justement, d’un objet qui empêche de penser, qui empêche de faire de la politique, qui empêche de contextualiser, d’historiciser. Et c’est au-delà de ça, par des techniques, des lois, des textes, des habitudes prises par les administrations, c’est ce que les Américains ont appelé face à la présidence Bush, la « self-full-fulling profecy », la prophétie auto-réalisatrice, la fabrication de son objet, une stratégie de la tension qui finalement en arrive à essayer de créer l’objet qu’elle recherche. C’est cette tension que ce pouvoir-là cherche, c’est cette tension légitimatrice qu’il cherche.
Donc ce que je voudrais dire, non pas en conclusion mais en ouverture d’un débat, et qui évidemment concerne ce lieux-ci et les trois parlementaires qui ont eu le courage finalement par rapport à d’autres et dans leur groupe, d’organiser ce colloque. C’est que derrière, il y a évidemment une question politique immense qui nous est posée : rien ne nous garantit aujourd’hui que face à une vague d’attentats dans ce pays, un Patriot Act de ce gouvernement, serait unanimement repoussé par l’opposition de gauche. Puisque nous avons vu, comment ce pouvoir-là a su parfois débaucher, corrompre, associer, diviser son opposition. Rien ne nous garantit qu’il y aurait ce front uni et rien ne nous garantit, pour les raisons qui ont été dites pendant toute cette journée, c’est que ce dont profite ces pratiques d’exceptions ne vient pas que de 2007, ne vient pas que de cette présidence mais a une longue histoire. Je suis d’accord avec certaines des interventions qui ont souligné combien cette longue histoire, et il n’y a pas besoin de comparaison historique, Lucien Febvre, le fondateur des Annales disait : « il n’y a d’histoire qu’au présent ». Cette histoire, c’est pour nous un travail sur le présent de s’en souvenir. De se souvenir que le génocide ne tombe pas de nul part, qu’il commence par le tri, qu’il commence par des lois d’exception, qu’il commence par des habitudes qui vont permettre le crime de bureau, qui vont permettre le délit de bureau, qui vont permettre toutes ces habitudes où, au fond, on ne fait plus attention à ce que l’on signe, à ce que l’on fait pour ceux qui sont au cœur des administrations, de pratiquer ce qui peut conduire au crime, ce qui peut conduire à l’injustice la plus totale.
La question que je voudrais poser c’est la question politique. C’est la question politique pour l’opposition d’aujourd’hui et qui sera peut-être la majorité de demain, et qui, grâce à quelques révélations présentes, quelques mobilisations sociales récentes, espèrent à nouveau être la majorité de demain. Et c’est une question politique centrale. Je voudrais, sans arbitrer entre M. Vallini et maître Comte, revenir sur ce mot culture de gouvernement. Bien sûr qu’il y a une responsabilité, mais la responsabilité peut être aussi une responsabilité des principes, peut être une responsabilité de la morale, peut être une responsabilité du droit. Est-ce que la culture de gouvernement c’est une responsabilité ?
Vous avez beaucoup évoqué l’Algérie. Je vous recommande, ce sera diffusé dans une semaine, et c’est en librairie dès maintenant, le film documentaire que vient de faire Benjamin Stora avec un confrère, et qui est associé à un livre, le livre François Mitterand et la guerre d’Algérie. Ce livre aura un effet sur la gauche et sa mémoire, aussi fort que l’a été le débat sur Vichy. Nous apprendrons en effet que l’homme qui est associé, François Mitterand ici même, à l’abolition de la peine de mort faite par Badinter, est l’homme, et Badinter témoigne dans ce documentaire, sous le gouvernement duquel en tant que garde des sceaux ayant le dernier mot au conseil supérieur de la magistrature, ont eu lieu le plus grand nombre d’exécutions capitales : 45 exactement pendant 500 jours de gouvernement. Nous verrons qu’il a toujours donné un avis défavorable aux demandes de grâce et nous lirons sa signature, nous verrons son écriture. Nous verrons qu’il a même refusé pour Yveton qui n’avait tué personne avec un explosif qui n’avait même pas explosé, qui était un militant communiste algérien. Nous verrons dans ce documentaire un document stupéfiant sur le débat sur le Patriot Act français que furent les pouvoirs spéciaux pendant la guerre d’Algérie et où est noté par l’un des ministres présents ce que dit à ce moment-là Guy Mollet : « je demande des pouvoirs dictatoriaux » et le mot dictatoriaux est écrit. Nous verrons que lorsqu’il y aura débat, Gaston Deferre est contre, Mendès France est contre, mais Mitterand est pour, et trois fois pour. Nous verrons que dans ce contexte il y a, parce que cela renvoie à cette époque : il y a eu aussi Suez un peu comme nous avons eu l’Irak. À ce moment-là, François Mitterand dit sur Suez : c’est un duel à mort. Bien sûr que l’homme a changé, que l’homme a évolué et que le temps a changé. Et qu’il ne s’agit pas de juger un homme, un homme est sur une vie et sur un chemin qui se fait.
Pourquoi je rappelle ça ? C’est à cause du mot employé par Antoine Comte de culture de gouvernement. Le documentaire et le livre de Benjamin Stora le montre très bien, François Mitterand savait tout cela, François Mitterand savait la torture, partageait l’indignation de beaucoup de ses amis qui étaient dans les mouvements qui protestaient à la ligue des droits de l’homme. Il avait des collègues, mais il a accompagné tout cela, et il a accompagné tout cela comme on gouverne, par adaptations successives, par culture de gouvernement. Par culture de cette responsabilité de gouvernement qui vous fait glisser, qui vous fait passer. C’est notre miroir, et pour les Américains s’est arrivé plus récemment, mais c’est notre miroir qui est là. Je rappelais cela parce que ce sera un débat public et ce sera un débat important qui pose cette question de la culture de gouvernement, et qui la pose à l’histoire même de la gauche.
Donc au fond, pour moi la question que pose cette affaire de Tarnac et le colloque d’aujourd’hui, c’est qu’est-ce que c’est que la démocratie ? L’une des vertus de la présidence de Nicolas Sarkozy c’est de nous obliger à voir en négatif ce qui est la nécrose de ce qui est au fronton de notre république. De voir que le mot république, que le mot démocratie peut être vidé de son sens. De voir qu’il n’a plus de vitalité, qu’il y a derrière une oligarchie, bref que le mot même n’a plus de réalité concrète. Les manifestations de cette semaine encore en sont bien la démonstration. On vote tous les 5 ans pour choisir son maître, et l’on doit retourner en servitude pendant 5 ans. Cette idée qu’au fond, la démocratie c’est choisir son maître et pendant ce temps-là, le reste du temps l’absence, l’absence du conflit, l’absence du débat, cette idée qu’il n’y aurait qu’une légitimité qui serait celle de la représentation et qu’il n’y aurait pas d’autre jeu dans la démocratie. Et je le dis ici là même, bien sûr qu’il y a une légitimité, celle de la représentation et des majorités. Mais des majorités, si le pays bouge, le pays change, c’est pour ça qu’il devrait y avoir un pluralisme de la presse, changer d’opinion le pays se mobilise, le pays s’organise, le pays conteste, le pays crée d’autres rapports de force, il n’y a pas que le vote. Il n’y a pas que l’instant du vote comme légitimité. Il y a la vitalité de la démocratie entre les deux.
C’est dans ce sens que ce débat du droit sur ces questions de liberté, sur ce refus des juridictions d’exceptions, renvoie à quelle conception de la démocratie avons-nous à opposer à ce que nous avons en face de nous aujourd’hui. Il ne s’agit pas de dire simplement on remplace et on sera meilleurs, on sera plus efficace, on sera plus légitime. Il s’agit d’être capable d’inventer autre chose, par rapport à ce qui s’est passé devant nous : cet affaiblissement encore plus fort de tous les contre-pouvoirs, de toute la diversité, de tout le pluralisme. Qu’est-ce que l’on peut reconstruire ? Pour reconstruire il faut être au clair sur quelle est notre conception de la démocratie ? Est-ce que c’est une immobilité, une fixité, qui conduit à cette nécrose que nous avons sous les yeux, ou est-ce que c’est une auto institution ? Est-ce que c’est un mouvement, une dialectique entre ceux qui sont élus et la société elle-même, et la façon dont elle s’exprime dont elle s’organise. Est-ce que il n’y a pas un lieu vide que nous devons en permanence inventer ? C’est une référence à quelqu’un qui est décédé récemment et à Claude Lefort, c’est une référence aussi, parce que au point de départ de Tarnac il y a la criminalisation des idées, d’un livre et d’un éditeur Eric Hazan. Eric Hazan, parmi ses nombreuses publications, a publié un petit recueil Démocratie dans quel état ? Dans ce recueil, qui confronte ce débat sur la démocratie, comment réinventer la démocratie ? Et bien dans ce recueil, je lis cette phrase faite par quelqu’un qui m’est cher et qui est décédé au début de cette année, Daniel Bensaïd : « le nombre n’a rien à voir avec la vérité, il n’a jamais valeur de preuve, le fait majoritaire peut par convention clore une controverse, mais l’appel reste toujours ouvert. De la minorité du jour contre la majorité du jour. Du lendemain contre le présent, de la légitimité contre la légalité, de la morale contre le droit ». C’est ça qui est au cœur de la vitalité démocratique. C’est à la fois ce souci et cela a été dit de l’individu, de l’individu comme clé des droits collectifs. Des respects des droits individuels comme levier pour créer des droits solidaires, des droits au niveau de la société, et donc de l’individu, y compris dans son altérité la plus totale, y compris dans sa différence, dans son étrangeté.
Cela a été le premier levier de l’affaire Dreyfus pour le mouvement socialiste et pour quelqu’un comme Jaurès, qui ne fut pas un dreyfusard de la première heure, et qui a vécu cette contradiction de faire ce chemin en se disant, j’ai tout pour ne pas être solidaire : c’est un officier, c’est un bourgeois, plutôt un réactionnaire peut être, il a une certaine morgue et en plus il est juif, l’antisémitisme n’ayant pas de borne sociale. Et l’on sait bien que le mouvement ouvrier a été saisis d’un combat qui renvoie à cette idée de l’efficacité.
Les cultures de gouvernement sont aussi des cultures de partis, des cultures de classe, des cultures de groupes, des cultures de nations parfois, où l’on choisit un intérêt général qui, du coup, va supprimer le souci d’un individu, parce que lui ne rentre pas dans l’intérêt général. Et ce moment fondateur de l’affaire Dreyfus qui en fait un mot, un mot clé pour toutes les libertés dans le monde, c’est cette idée que même l’individu qui nous est le plus éloigné, si ses libertés, ses principes sont en jeu le concernant nous sommes concernés.
En l’occurrence dans le caractère tardif des réactions de la gauche de gouvernement sur l’affaire de Tarnac, c’est bien cela qui fut en jeu. Au fond ces gauchistes, au fond ces lunatiques, au fond ces radicaux, au fond ces extrémistes, tout cela nous est étranger, donc ce n’est pas responsable de nous en préoccuper et pourtant les principes qui nous concernent tous étaient en jeu dans l’affaire de Tarnac.
Mais l’autre aspect, d’où ma citation de Daniel Bensaïd, c’est la question des minorités. La démocratie c’est le souci du droit de l’individu. C’est la fameuse phrase de Péguy : « Un seul crime et tout le contrat social est rompu, une seule injustice suffit pour mettre le déshonneur sur tout un peuple. » Mais c’est aussi cette idée qu’il y a, en démocratie, un espace pour ce qui est différent, ce qui est minoritaire, qui sera peut-être la majorité de demain. Ce qui est à la marge, ce qui est à la frontière, ce qui ne rentre pas dans les codes. Et que l’honneur de la démocratie, c’est d’être capable de laisser cet espace, de laisser cette respiration.
Bien sûr cela n’empêche pas qu’il y a des lois, qu’il y a des actes qui peuvent être jugés. Tout cela peut fonctionner, sans exception, mais cette idée, derrière tout ce qui a été dit sur les lois d’exception, et la fabrication du mot terrorisme comme un syntagme qui vous prend, qui criminalise les idées et les déviances. C’est cette idée qu’il ne doit pas y avoir de déviance, d’écart, de minorités agissantes ou silencieuses. Qu’il ne doit pas y avoir quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et au fond, vous le voyez dans les débats, y compris sur la diversité de notre peuple, ce mot « assimilation » qui est renvoyé à toute une partie de la population française au lieu de dire intégration, vivre ensemble, etc. , renvoie à cette idée : on doit tous être semblables. Alors que la démocratie c’est cette pluralité, ce conflit qui va peut-être créer de nouvelles espérances, créer de nouvelles surprises, laisser la place à l’inattendu, à l’imprévu.
Je dis cela parce qu’on est dans un lieu fondateur de la République et je voudrais rappeler aux républicains d’aujourd’hui que face à ce qui nous arrive et au risque de ce qui est devant nous, il faut qu’ils retrouvent l’audace de ceux qui ont vraiment fondé la République. Je ne parle pas de la première, et de la deuxième bien sûr, l’idéal est fondé sous la première, il est redéfendu sous la deuxième, mais nous savons bien qu’au fond le moment fondateur c’est celui de la première troisième République, celle qui va d’après la Commune de Paris (ndlr. 1875) jusqu’à 1914.
Or je voudrais rappeler ici ce moment, qui je crois a été un peu évoqué et qui est important, dans son enchaînement, oui dans son enchaînement. Les anarchistes, les libertaires de cette époque défendaient la propagande par le fait. Ils ne faisaient pas que des textes, ils ne faisaient pas qu’écrire. Ils ont défendu face à une société qui avait oublié les massacres de la commune, face à une société d’industrialisation et de révolution industrielle violente, l’idée, oui de l’acte violent, y compris cette idée contre des innocents, y compris dans des cafés, en disant « il faut que le bourgeois voit ce qui lui arrive » Ils ont fait cela. Ils n’ont pas fait ça à petite échelle, je rappelle qu’ils ont, quand même, tué un président, qu’ils ont mis une bombe dans cette assemblée même.
Thierry Lévy : « Sans tuer »
Edwy Plenel : « Sans tuer oui »
Dans ce contexte, saisissant ces actes, autrement graves, à la suite de l’acte de Vaillant dans l’enceinte du Palais-Bourbon, ont été adoptés, ce qui, beaucoup plus tard, sera appelé les lois scélérates. Celle du 18 décembre qui introduit le crime d’association de malfaiteurs, donc d’une responsabilité collective, qui fait passer ces responsabilités collectives devant les responsabilités individuelles. Et l’autre du 12 décembre, modifiant la loi sur la presse de 1881, qui vise les textes, l’appel, l’infraction de provocation au crime, et après l’assassinat du président Carnot le 28 juillet 1894 la propagande sur les menées anarchistes dérogatoires aux droits communs. Pourquoi je rappelle cela ? Parce que dans ce contexte aura lieu un procès, important, l’été 94 qui est le procès des 30, c’est le procès dit des intellectuels de l’anarchie, août 94 ; je rappelle que pour Dreyfus, son arrestation est en octobre 94, tout, cela est dans le même contexte. Ce procès des intellectuels de l’anarchie, qui rassemble quelque chose d’hétéroclite, va se retourner contre son accusation, ça va être une pantalonnade, les 30 vont être acquittés, dont Fénéon qui est un anarchiste libertaire, un auteur, un écrivain, et qui va être au cœur de ce procès. Je rappelle juste que c’est à ce procès que le mot intellectuel est inventé, ce n’est pas au moment de l’affaire Dreyfus. « Nous les intellectuels », comme nommera le président.
Qu’est-ce qui se passe après ce procès et après la libération de Fénéon ? L’avocat de Fénéon, Edgar Demange, va devenir le premier avocat de Dreyfus. Fénéon qui va être la figure de ce procès va devenir l’âme de la revue blanche qui sera la revue de toutes les avant-gardes de cette époque un peu comme les éditions Hazan sont un lieu original, d’avant-garde, La Fabrique. Dans cette revue blanche, qui va publier les mémoires sur la Commune de Paris, qui va publier toute une mémoire républicaine, vont s’exprimer tous ces intellectuels de l’anarchie, tous ces libertaires et, c’est là où je voulais en venir, ces gens qui ont été l’objet des lois scélérates, c’est eux qui vont être les premiers défenseurs de Dreyfus.
Et je rappelle qu’entre octobre 94 et janvier 98 ; le J’accuse de Zola, il y a donc presque 4 ans. Quatre années pour que l’opinion sur Dreyfus se retourne, l’opinion de ceux qui sont au Parlement, et qui menaient la bataille ? Ce sont les libertaires qui ayant été victimes des lois scélérates, un peu la pédagogie que le groupe de Tarnac nous fait aujourd’hui, puisque c’est eux qui nous donne l’occasion de faire ce colloque. Ce sont les libertaires qui ont été le levier en allant frapper aux portes de l’injustice frappant Dreyfus. C’est Bernard Lazare, premier défenseur de Fénéon, lui-même libertaire, qui fait ce chemin-là. C’est dans la revue blanche, qu’en juillet 1898, sous la responsabilité de Fénéon, l’un de ces intellectuels de l’anarchie, dont je signale juste que ses biographes disent qu’il avait quand même mis dans un pot de fleurs un petit engin explosif au bord d’un restaurant près du Sénat, qui n’a fait qu’un blessé, lui même libertaire, ce qui parfois choquent certains libertaires quand on le leur rappelle et qui disent que c’est peut être sa biographe américaine qui a inventé ça, mais peu importe. Je dis juste qu’ils font, eux-mêmes dans cette épreuve qui sera la leur, un chemin vers l’exigence démocratique au cœur de la république, ils vont rentrer dans ce mouvement-là, ils vont passer dans ce mouvement-là. C’est ce que nous fait ici l’histoire de Tarnac à l’Assemblée Nationale.
Et c’est dans la revue blanche que paraît, en juillet 1898, sous la signature d’un juriste, sur comment ont été faites les lois scélérates : « Telle est l’histoire des lois scélérates. Il faut bien leur donner ce nom, traduisez lois d’exception, juridiction d’exception, c’est celui qu’elles garderont dans l’histoire, elles sont vraiment les lois scélérates de la république. J’ai voulu montrer non seulement qu’elles étaient atroces, ce que tout le monde sait, mais ce que l’on sait moins, c’est avec quelle précipitation inouïe, avec quelle incohérence absurde ou quelle passivité honteuse, elles avaient été votées ». L’homme qui signe anonymement ces lignes, c’est Léon Blum, qui, à l’époque, fait ce chemin-là aussi. Et suit en janvier 1899, hommage, à notre ami Dubois et la ligue des droits de l’homme, un article de Francis de Pressensé, l’un des premiers fondateurs de la ligue des droits de l’homme, Notre loi des suspects : « la France a connu à plusieurs reprises au cours de ce siècle, ces paniques provoquées par certains attentats, savamment exploités par la réaction et qui ont toujours fait payer à la liberté les frais d’une sécurité menteuse. Quand un régime promulgue sa loi des suspects, quand il dresse ses tables de proscription, quand il s’abaisse à chercher d’une main fébrile dans l’arsenal d’une vieille législation les armes empoisonnées, les armes à deux tranchants de la peine forte et dure, c’est qu’il est atteint dans ses oeuvres vives, c’est qu’il se débat contre un mal qu’il ne pardonne pas. (C’est la corruption qui était évoquée toute à l’heure) c’est qu’il a perdu, non seulement la confiance des peuples, mais toute confiance en soi-même »
J’évoque cela parce qu’il y a eu ce cheminement en si peu de temps, si peu de temps : 1894 – 1898. Et la période dont vous avez parlé pendant tout ce colloque est une période qui s’étale sur 20 ans. Où ce ressaisissement n’a pas eu lieu. Et donc c’est ce ressaisissement qu’on attend en 2012. C’est ce ressaisissement qui va assumer face à tous ces compromis faits au nom de la peur, au nom de la violence, au nom de ce qui est brandi comme une stratégie de la tension. C’est cela qu’on attend c’est-à-dire une authentique altérité, une authentique radicalité démocratique.
Dans l’article de soutien à Coupat, et j’en terminerai là, en expliquant que ce n’est pas un soutien ni à ce qu’il pense, ce que je ne sais pas, ni à ce qu’aurait réfléchi le groupe de Tarnac, mais un soutien par rapport à la situation qu’ils vivaient et qu’ils vivent toujours. Je rappelais le livre d’un Italien, Leonardo Sciascia, qui est un livre prophétique d’un écrivain sur la stratégie de la tension. C’est le contexte traduit qui a donné ce film : Cadavre exquis.
L’histoire de Tarnac commence aussi avec un livre qui sera brandi au journal télévisé L’insurrection qui vient, je rappelle que le policier républicain, le policier soucieux des formes juridiques est renvoyé, par ceux qui veulent instrumentaliser tout cela, à la bibliothèque. On lui dit de lire un livre, on lui dit de lire des livres, et il suffit de lire des livres pour les accuser, c’est-à-dire qu’au fond, c’est la littérature, c’est l’écriture qui est coupable, c’est l’écriture qui est responsable. La postface que fait Sciascia, après que cette stratégie de la tension se soit réalisée, le roman est d’avant les attentats, les lois d’exceptions, il dit « si tout cela s’est réalisé, c’est parce qu’il avait inventé un pays où n’avaient plus court les idées, où les principes encore proclamés et célébrés étaient quotidiennement tournés en dérision, où les idéologies étaient réduites à seule fin politique, un pays où le pouvoir seul comptait » et il terminait « un pouvoir qui de plus en plus prend la forme obscure d’une chaîne de connivence, approximativement la forme de la mafia »
Je pense très sincèrement que nous sommes dans une situation semblable, une situation de connivence, de corruption, d’oligarchie, de pièges, de liens. Et je pense que beaucoup de ceux qui sont dans cet hémicycle le savent aussi bien que moi. Je pense que face à cela, au-delà de la diversité des sensibilités, c’est un paradoxe, les idéaux originels d’une république profondément républicaine, réellement égale, réellement juste, réellement libre et réellement fraternelle, d’une république radicalement démocratique, ont l’occasion de trouver une seconde jeunesse dans une radicalité. Non pas dans un compromis où l’on essaierait d’avoir des avantages pour demain mais dans une exigence du présent. Voilà ce que je voulais dire.